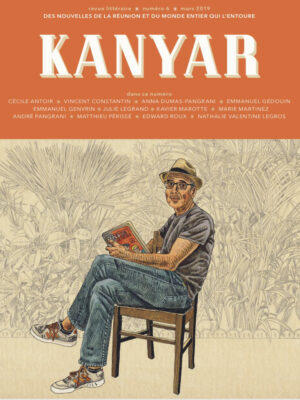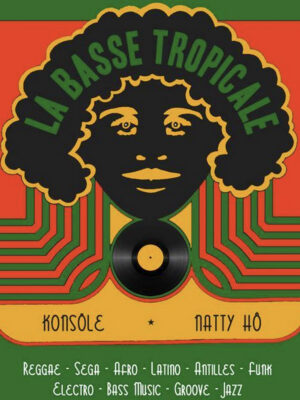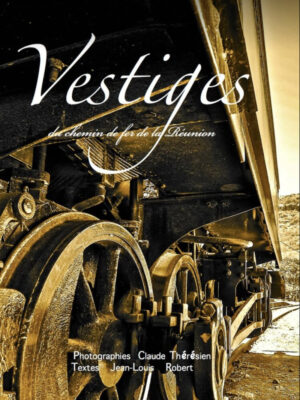À mi-chemin entre le bal des débutantes, le love-dating et la maison close, le bal Ma…
Le bal des Noirs annonçait-il la créolité ?
Interdit en 1819 par le gouverneur Milius, le bal des Noirs sera en fait considéré avec une «indulgence paternaliste»… pourtant les musiques qui forment cet environnement musical révèlent une dissonance fondamentale dans l’univers bourbonnais : celle de l’esclavage ! Sans doute les planteurs ont-ils pensé et prescrit un monde apaisé. Mais la perpétuation de l’image d’un Eden ancien où, selon la tradition mythique, ils étaient leurs seuls et propres maîtres, où l’appartenance n’était pas allégeance, dénonce la vision quasi-ethnographique du présent comme un passé toujours là.

Les « danses des nations« …
Les sucriers ne peuvent pas ne pas voir les contraintes de ce monde dans lequel ils s’inscrivent de plus en plus étroitement, au plan économique et au plan politique. Des enjeux majeurs de leur époque qui forcent leur coutume, le plus important et le plus tragique est l’esclavage. Au cœur même de la vision prétendument apaisée du monde qu’ils ont édifiée gît la fracture de l’esclavage. La musique des Noirs en exhibe le stigmate.
L’environnement des sucriers intègre la musique des Noirs. Cette expression, employée couramment au XIXe siècle, globalise, par facilité, la musique des non-blancs, libres et esclaves. Il faut au contraire rappeler la pluralité des musiques serviles1, qu’atteste dans son «Journal politique», Pierre Amable de Sigoyer2 : «Chaque caste de Noirs se réunissait à part en groupe et dansait les danses des nations. Le baubre [sic], le cayambe, le tambour et d’autres instruments dont j’ai oublié les noms composaient les orchestres».
À certains égards, cet environnement musical forme un espace sonore qui fonctionne comme une zone de contact. Les esclaves ont universellement acquis la réputation d’être «naturellement doués» pour la musique3, et relativement nombreux sont les témoignages sur la musique des Noirs, pour laquelle on professe d’ailleurs une indulgence paternaliste assez générale.

Les maîtres sont autorisés à laisser danser leurs esclaves les dimanches et jours fériés
Certes, une ordonnance du gouverneur Milius, en date du 18 mai 1819, interdit le bal des Noirs, mais le même Milius qui a pris cette décision autorise les maîtres à laisser danser leurs esclaves les dimanches et jours fériés ! Ils se réjouissent ainsi aux mêmes occasions que leurs maîtres, circonstance qui, à tout le moins, a favorisé l’écoute voire la réflexion.
Lescouble note, le jour de Pâques 1812 : «Nous avons passé la journée joyeusement et le soir nous avons dansé des contredanses, après quoi les domestiques4 se sont amusés quelques heures à danser et à rire».
Il n’est pas rare que des esclaves utilisent les instruments des Blancs : «Paulin, commendeur de Lachapelle, est venu ce mattin me voir et m’a demandé de la colle forte pour coller son violon», écrit Lescouble5, qui observe ailleurs : «J’ai rencontré aussi en route Sidonie, sœur de Bellonie la joueuse de guittare», une esclave qui préfigure peut-être la célèbre Célimène.
D’une manière générale, la musique dite des Blancs est souvent jouée par les musiciens qui n’appartiennent pas au groupe des Blancs. Dès lors les esclaves s’approprient une partie notable des chants des maîtres : romances6, airs de vaudeville, mais aussi cantiques.

Les Noirs et leur musique apparaissent bien présents dans l’environnement musical de Bourbon
L’abbé Macquet en témoigne : «Dès cinq heures du matin, j’entendais mille voix retentir sur tous les sommets d’alentour ; c’étaient les esclaves catholiques qui (…) descendaient allègrement les pentes des montagnes pour assister à la messe de six heures. (…) Avec quelle foi ces hommes et ces femmes se prosternaient ! (…) Comme la grâce opérait dans ces âmes neuves et impressionnables ! (…) A un signal donné, ces douze cents voix entonnent avec entrain un de nos beaux cantiques des missions»7.
Sans doute n’y a-t-il pas lieu d’envisager à Bourbon une hymnologie catholique servile ; toutefois, l’apprentissage par les esclaves des cantiques et des psaumes en vigueur dans leur paroisse — parfois plusieurs dizaines, et jusqu’à quatre-vingts, en français mais aussi en latin ! —, chantés à l’église mais aussi lors de cérémonies usuelles comme les mariages, les baptêmes et les enterrements, présente des avantages pour l’évangélisation : il fournit un «moyen aisé et séduisant de retenir un enseignement doctrinal élémentaire»8 et, en facilitant l’accès au baptême, permet l’intégration des esclaves et préface «l’amélioration» de leur statut.
Leur christianisation, le fait qu’ils soient en réalité «appropriés» au christianisme des maîtres, doit survivre à l’abolition, et favoriser leur assimilation en tant qu’affranchis dans la future société, conformément à l’objectif des lois Mackau. Dès lors, les Noirs et leur musique apparaissent bien présents dans l’environnement musical de Bourbon.

1828 : des actrices blanches et des actrices noires réunies sur scène provoquent l’indignation
Le théâtre enfin semble n’avoir jamais été absolument interdit aux Noirs, même avant 1848. Du temps de la troupe Hortus, entre 1805 et 1810, des actrices de couleur jouent la comédie9. En 1828, la troupe Armand réunit sur scène des actrices blanches et des actrices noires, ce qui indigne le public : le maire de Saint-Denis, Petitpas10, dénonce le fait au Directeur de l’intérieur, mais Armand obtient gain de cause.
Dès 1828, un public noir est attesté, que le public blanc juge trop nombreux, ruinant l’élégance d’un lieu où se retrouve l’élite de l’île. Les visiteurs sont étonnés de cette mixité, qui rapproche à tout le moins les libres et les libres de couleur — qu’ils dénomment mulâtres, terme peu usité à Bourbon : «Je suis allé à l’Opéra. La salle était pleine ; il est vrai qu’elle n’est pas très-grande ; il n’y a que deux étages de loges ; aux premières, s’épanouissent les beautés blanches dans le luxe de toilette le plus éblouissant ; aux secondes, les mulâtresses, encore plus somptueusement parées et non moins belles»11.
En 1830, le maire sermonne le régisseur : «Vous avez abaissé de trois pieds le paradis qui renferme les Noirs et les négresses afin d’en contenir un plus grand nombre, nous en avons déjà trop ; cette récréation n’est pas en harmonie avec leurs facultés» ; et le premier magistrat ordonne de refuser l’entrée du théâtre à tout esclave qui n’est pas porteur d’une permission écrite de son maître.

Sans doute pensait-on que l’admission des Noirs au théâtre jouait un rôle de « soupape de sûreté »
La situation de ce public servile est intéressante. Les autorités n’osent pas l’exclure des représentations, d’abord sous la pression des régisseurs qui peuvent ainsi plus ou moins rentrer dans leurs frais, sans doute aussi parce que l’on pense que l’admission au théâtre joue le rôle de «soupape de sûreté», peut-être enfin car l’on estime que les Noirs peuvent s’approprier de la sorte les éléments d’une culture qui les polisse : la musique n’adoucit-elle pas les mœurs, selon l’adage ?
Cela n’empêche pas, jusqu’en 1848, l’indignation de se manifester dans les lettres adressées aux autorités et dans la presse, contre ce public jugé souvent fruste, telle cette envolée raciste de Georges Azéma en 1842 : «Le paradis offre ses bienheureux élus, Noirs comme des réprouvés de l’enfer, qui n’entendent rien, ne comprennent rien, mais rient à gorge déployée de ce qui fait pleurer les autres»12. Mais ce que le critique met sur le compte de la stupidité des esclaves n’est à vrai dire que la subversion — jugée insupportable — des codes culturels de ce qu’il pense naïvement être un «bon goût» universel, celui des blancs.

La musicalité prophétise-t-elle la créolité bourbonnaise ?
Quant aux esclaves, hors ces manifestations collectives, ils adoptent généralement une attitude réservée, pour ne pas encourir les foudres de l’autorité. Ils n’en entendent pas moins la musique des Blancs, en retiennent les airs.
Le vers célèbre de Lacaussade13 «Ton âme, ô mon pays ! A passé dans ma voix»14 fait écho à cette réception dans la réalité triviale de la plantation perçue cependant alors comme un espace élitaire, et configure de l’extérieur la société insulaire, attestant que la musicalité prophétise la créolité bourbonnaise.
Les Blancs quant à eux ne dédaignent pas de s’approprier à l’occasion la musique des esclaves. «Le repas a été gai, animé. On a porté les santés, chanté des couplets maloyas, etc., etc., comme de coutume», écrit Lescouble en 1834. Sur scène, il arrive parfois, sous couvert de couleur locale, que l’on exécute des airs de la musique des esclaves ; sans doute les autorités le déplorent-elles, pour de nombreuses raisons, mais le public adore15.

Un ballet de Noirs dansant et chantant le séga est introduit dans une représentation de « Paul et Virginie«
En 1839, lors d’une représentation de Paul et Virginie, est introduit un ballet de Noirs dansant et chantant le séga ; l’Indicateur Colonial s’ébahit : «C’est une innovation peu heureuse que d’avoir fait figurer de véritables Noirs dans ce ballet, et c’est une idée plus inconvenante que d’avoir fait danser le Séga en pleine scène. Quant au “Pas de cocos” dansé ou plutôt sauté par six petits Noirs, il a bien quelque originalité, mais j’ai été surpris, je l’avoue, du succès pyramidal, colossal, idéal qu’il a obtenu ; c’étaient des applaudissements, des trépignements, des acclamations effrayants ; on a même crié bis».
Et pour cause : dans son évocation de la danse du séga, Freycinet relève : «On éprouverait moins de plaisir à la voir si elle était exécutée par d’autres acteurs, et si les postures voluptueuses qu’ils y affectent ne dégénéraient vers la fin en une indécence révoltante»16.
Quelles qu’en soient les motivations, il y a donc des échanges entre musique des Blancs et des Noirs. Lescouble en témoigne dans un épisode ambigu : «Un Noir à Hugot, soul comme le tambour du diable, nous a amusés singulièrement. Il a fait venir un bobre et s’est mis à danser d’une manière si originale qu’il était impossible de conserver son sérieux ; il a forcé les petits Noirs à danser avec lui et employait des expressions si plaisantes pour les y engager qu’il était impossible de voir une scène plus risible. “Naturellement“, “c’est fort bien” et d’autres expressions de ce genre. Il a ensuite chanté des romances et alors il a été impossible d’y tenir. Nous sommes partis tous avec le mal de tête à force de rire» [1822].

L’espace musical est ainsi, selon Jean-Pierre La Selve, le lieu privilégié du métissage…
Et Sigoyer confirme à sa manière : «Les Noirs créoles et les autres bien francisés se réunissaient ensemble. (…) C’était pour chanter qu’ils se réunissaient. Que chantaient-ils ? Ballades, romances, chants patriotiques composés par eux-mêmes».
L’espace musical est ainsi, selon Jean-Pierre La Selve, le lieu privilégié du métissage, le séga, identifié au début du XIXe siècle, en est l’exemple le plus frappant17.
Cependant, plus qu’une simple tolérance sociale envers la musique des Noirs18, on note parfois pour elle un véritable intérêt. Au-delà de la curiosité ethnographique, le ressenti de la musique servile entre dans l’assemblage identitaire des Bourbonnais : «J’ai noté ce soir la chanson pour tirer la dernière cuite de sucre (hia la)», note Lescouble en 1824 à propos du chant entonné par les esclaves pour célébrer la fin de la «manipulation»19.

Pour Baudelaire, le bobre est malgache, pour Lacaussade et Chrestien, il est africain
«Comment trouvez-vous cette musique ?» demande de son côté un habitant qui accompagne Auguste Billiard, en entendant la musique des Noirs qui monte d’une caféterie ; «Le créole, ajoute-t-il, qui après un long voyage reviendrait dans sa patrie, ne pourrait, ce me semble, entendre sans émotion ce chant des Noirs qui travaillent dans la montagne»20.
Les planteurs n’en ressentent pas moins l’étrangeté de la musique servile, ces «chants sauvages mais cependant harmonieux»21. En premier lieu celle des instruments, parmi lesquels ils n’identifient guère que l’ancive, le tam-tam, le bobre, le vali22, sur l’origine desquels ils n’ont d’ailleurs guère de certitudes, même s’ils les décrivent correctement : pour Baudelaire, le bobre est malgache, pour Lacaussade et pour Chrestien, il est africain.
Les observateurs sont aussi déroutés par la profusion des chants d’esclaves, sans parvenir véritablement à l’expliquer. Quels que soient les travaux exécutés — défrichage des champs, labour, coupe de la canne, préparation du sucre etc. — les Noirs chantent : «Quand le nègre se sert du marteau, il frappe en mesure, quand ils creusent des sillons, ils ont des mouvements cadencés ; ils chantent en travaillant dans la plaine, ils chantent en revenant du travail»23.

Ces chants de travail se font désormais en créole, langue de communication entre le maître et l’esclave
Prisonniers de leurs préjugés et du postulat d’une musique expressive24, les Blancs n’identifient pas formellement ces chants comme chants de travail, d’atelier ou de bandes, de portage25, etc., et les interprètent à contre-sens : «Les bons courageux Noirs sont arrivés, se tenant les uns les autres par la main, pour résister au torrent, et chantant ensemble une chanson créole pour s’exciter. (…) Seulement, je ne comprenais pas qu’ils eussent le cœur de chanter, en nous voyant ainsi exposés», écrit Victorine Monniot26, et l’abbé Macquet note : «Les chants joyeux des rameurs étaient pour nous une distraction».
Ces chants de travail27, formes héritées des cultures originelles, qui donnent le courage, l’énergie et créent la joie selon des traditions antérieures à l’esclavage, se font d’ailleurs désormais en créole, langue de communication entre le maître et l’esclave. Il n’est pas rare que ce chant créole établisse une connivence humoristique avec le maître : «Notre gibier est triomphalement emporté au chalet par les esclaves ; là, ils chantent et l’adresse des tireurs, et les mérites des pièces abattues», écrit encore Macquet, etc.
Ce que les planteurs interprètent comme l’incorporation de l’ordre servile par l’esclave, marquant à leurs yeux l’enracinement progressif des asservis dans l’ici bourbonnais et leur acculturation, ne révélant rien en revanche de la souffrance, de l’exploitation ou de sa subversion : sans doute considèrent-ils le chant — ainsi pensait Rousseau — comme un signe de l’état précivilisé et naturel ; d’une certaine façon, les formes de l’ethnicité priment sur le statut de servitude.

Aux sons mélancoliques du vali et du bobre…
Car la musique des esclaves est perçue à travers les grilles de lecture européennes. Les Blancs la jugent habituellement rudimentaire, selon un préjugé qui eut la vie longue : dans les années 1930, Mareschal de Bièvre évoque encore ces «esclaves [qui] écoutaient avec une stupeur ravie ce concert que leur donnaient les maîtres : ils comprenaient malaisément un art si fort au-dessus du sentiment primitif dont procédaient leurs traînantes mélopées»28 ! Elle est surtout jugée triste : «La musique des Noirs n’est pas gaie», note laconiquement Monniot.
On la confine en effet à l’expressivité : «Combien de fois me suis-je endormi aux chants du Noir, aux sons mélancoliques du vali et du bobre, qui se prolongent souvent jusqu’au milieu de la nuit !», écrit Billiard [1822], «ils ont le bobe [sic], qui est si mélancolique, qu’il me donne toujours envie de pleurer quand je l’entends, le soir, dans le lointain» renchérit Monniot, alors que Freycinet note [1827] : «Les Noirs aiment beaucoup la musique. Ils composent (…) de petits airs, presque toujours pleins d’une expression mélancolique, et dont la mélodie plaît à l’oreille européenne la plus exercée»29. Sans doute faut-il voir dans cette appréciation une projection de la mauvaise conscience des Blancs face au fait servile.

Une sorte de communauté culturelle auditive entre maîtres et esclaves
Mais cette musique est surtout rejetée du côté d’une ethnicité barbare et sauvage : «Les instruments sauvages éclatèrent à la fois ; les tambours que les Noirs battaient avec fureur, les calebasses pleines de petits grains secs, les bobres, enfin tout l’attirail de ces symphonies barbares», écrit ainsi Eugène Dayot30. Une telle musique demeure au fond incompréhensible aux Blancs, comme en témoigne ce célèbre passage d’Auguste Billiard. Cheminant dans les hauts de Saint-Paul, Billiard est peu à peu saisi par le chant des esclaves au travail du café sur une habitation : «Je crus entendre, écrit-il, j’entendis en effet, mais d’une assez grande distance, un chœur à deux parties dont les voix parfaitement d’accord tombaient et se relevaient tour à tour : les chants étaient interrompus par des sons prolongés presque pareils à ceux du cor».
Dans un premier temps, l’auteur est saisi par l’harmonie rythmée de ce qu’il identifie parfaitement comme une musique servile, dont l’harmonie qu’il perçoit ne peut que traduire une sorte d’acceptation du vécu des esclaves, le travail forcé. Les lignes qui suivent renforcent cette impression, car la musique semble offrir, malgré son originalité, «quelque ressemblance avec le ranz-des-vaches de la Suisse», ce qui la fait entrer dans une catégorie identifiée comme européenne ; l’habitant qui lui en fait la remarque souligne d’ailleurs — on l’a vu — combien les créoles blancs sont sensibles à ces sons.
Il y a donc une sorte de communauté culturelle auditive entre maîtres et esclaves. Mais elle s’est établie dans le lointain, qui est au sens propre la distance qu’établit entre le Blanc et le Noir la construction théorique de l’esclavage, suggérant une harmonie entre travail forcé et esclave. Lorsque Billiard s’approche, cette harmonie qu’il a cru percevoir dans le chant s’évanouit, et ne demeure que le seul rythme : «A mesure que nous montions, les chants plus rapprochés perdaient le charme que le lointain leur avait donné. En arrivant au milieu des Noirs, ce n’étaient plus que des cris sauvages, mais cependant en mesure et parfaitement d’accord».

« Caché derrière un arbre, j’observais curieusement ce singulier spectacle dont la folie m’attristait »
Presque trente ans plus tard, Lavollée assiste à son tour, subrepticement, à un bal d’esclaves. « (…) J’entendis au loin les sons d’un orchestre et de voix joyeuses. Bien que rassasié de musique, je me dirigeai machinalement de ce côté et me trouvai bientôt au milieu d’une danse nègre. (…) Autour d’un orchestre rauque et criard, mais qui pourtant ne manquait pas d’une certaine mélodie, une foule compacte de nègres et de négresses se livrait à toutes les excentricités du bamboula31. Quelques groupes chantaient ou plutôt criaient à tue-tête un jargon inintelligible, réminiscence dépaysée de la côte africaine ; d’autres s’enivraient de rack, avant de retourner aux danses. C’était l’orgie de la liberté, aux seules heures qui n’appartiennent pas à l’esclavage. Je m’étais caché derrière un arbre, et j’observais curieusement ce singulier spectacle dont la folie m’attristait. (…) Enfin, j’étais parvenu à voir quelque chose qu’on ne voit pas à Paris, et, à la suite de mes deux bals, je pouvais rêver blanc et noir»32.
Les auteurs formulent la même analyse, signe qu’il s’agit véritablement d’un schème perceptif — construit, culturel — propre aux maîtres blancs. Mais chez Billiard, la réduction du musical à la seule dimension rythmique abolit l’illusion de l’intégration des esclaves à l’univers musical et culturel des Blancs. Car ce qui manque à leur chant, perçu exclusivement comme rythmique, c’est l’unisson, une même note chantée simultanément par plusieurs chanteurs, dont l’absence prive le chant des esclaves de toute dimension harmonique ou mélodique. L’octave en tant qu’intervalle incarne — dans la culture musicale des maîtres informée par Platon — l’union du même et de l’autre33 : les deux notes de l’octave sont deux, mais en même temps ne sont qu’une dans l’unisson. Son absence dans la perception qu’en ont les planteurs sanctionne l’étrangeté radicale de la musique servile et celle des esclaves à l’univers des maîtres.

La musique des esclaves prophétise la liberté imminente
Chez Lavollée au contraire, l’étrangeté de la musique servile que relève aussi l’auteur connote la liberté à venir, car l’abolition est désormais perçue comme inéluctable et prochaine, ce qui n’était pas le cas à l’époque de Billiard. La musique des esclaves anticipe et sans doute prophétise cette liberté imminente. Pourtant la liberté des noirs sera sans doute d’une nature spécifique, et ne sera pas celle des blancs.
La musique très présente dans la vie de l’île produit un environnement qui fonctionne peu ou prou comme un lieu de sociabilité dans une société qui en compte peu, sans doute aussi un lieu de mémoire, aménageant de ses rythmes le temps contraint de la colonie. La musique produit dès lors un véritable lien social entre le pouvoir institutionnel et les planteurs, à l’intérieur de leur groupe, entre eux et le monde servile.
Mais loin de produire une consonance entre ces univers, comme feignent de le croire les habitants, les musiques qui forment cet environnement musical révèlent une dissonance fondamentale dans l’univers bourbonnais : celle de l’esclavage, dont les planteurs affectent de penser qu’il a été approprié à la réalité insulaire.
Jean-François Géraud
Maître de Conférences
CRESOI – OIES
Université de La Réunion
Lire aussi :
- Le chaînon manquant du séga-maloya ?
- Siya, une Indienne au cœur du maloya ?
- Maloya : kisa i koné zistoir «Dodo Siya ?»
- Séga-maloya : la «symphonie sauvage»
- Chansons-lontan : ségas pas sages ! (1)
- Chanteurs de rue : le bruit mat des pieds nus qui s’éloignent
- 1949 : un «maloya» aux déhanchements afro-cubains
- Moringue 1920 : «Sors devant moi, sinon…»
- Marc Mirault : Kaf kafrine i veut pas danser
- Noël avait Maria
- Lacaussade, né et mort parmi les révoltés
- Révolte des esclaves : le syndrome de Saint-Leu
- Esclavage et amour : lété pas doux !
- A la recherche du roulèr originel
- FètKaf : il manque un doigt au pied d’Estelle
- La Basse Tropicale extrait l’or de la pop gasy des années 70
- La ballerine était en noir
- Et que Jacqueline Rosemain spécifie, peut-être à l’excès, dans son ouvrage, «La Musique dans la société antillaise. 1635-1902. Martinique, Guadeloupe», Paris, L’Harmattan, 1986, 184 p.
- Républicain convaincu, ce « diariste » réunionnais se félicite, dans son «Journal politique» (1848-1861) de l’avènement de la Deuxième République et de l’abolition de l’esclavage. ADR.
- Denis-Constant Martin, « Le Cap ou les partages inégaux de la créolité sud-africaine », Cahiers d’études africaines, 168 | 2002, p. 687-710, URL : http://etudesafricaines.revues.org/162.
- Il faut entendre : «Les esclaves domestiques».
- Nous respectons son orthographe erratique…
- La romance, genre « naïf et attendrissant » (Marmontel) est en vogue depuis le milieu du XVIIIe siècle, en même temps que l’opéra-comique. Elle succède à la chansonnette dont elle semble une forme plus relevée, expression prosaïque et bourgeoise de l’esprit français.
- Abbé Macquet, «Six années à l’île Bourbon», Alfred Cattier, Tours, 1892, 230 p., p. 77.
- Paul-André Dubois, «De l’oreille au cœur ; naissance du chant religieux en langues amérindiennes dans les missions de Nouvelle-France (1600-1650)», Sillery, Septentrion, 1997, 151 p. (Nouveaux Cahiers du CELAT, n° 19).
- Françoise Michèle Vidot, «Histoire du théâtre à La Réunion. Des origines à 1880», mémoire de Maîtrise de Lettres modernes, dir. M. Carayol, octobre 1983, Université de La Réunion, 307 p.
- Jean-Baptiste Petitpas, né en 1772 à Grenoble, arrivé en 1792, avoué et sucrier, maire de Saint-Denis de 1820 à 1828.
- Th. De Ferrière Le Vayer, «Une ambassade française en Chine. Journal de voyage», Paris, Lib. D’Amyot, 1854 (à Bourbon en 1843), 406 p.
- «Indicateur Colonial» n° 398, 12 novembre 1842.
- Lire à ce sujet : Lacaussade, né et mort parmi les révoltés.
- Auguste Lacaussade, « A l’île natale », Poèmes et Paysages, Paris, A. Lemerre, 1897, 360 p.
- Les régisseurs, perpétuellement en déficit, sont obligés d’ajouter des intermèdes musicaux donnés par les amateurs, des ballets exécutés par les esclaves, pour remplir leurs caisses.
- Louis Claude de Saulces de Freycinet, «Voyage autour du monde exécuté sur les corvettes de S. M. l’Uranie et la Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820», 11 volumes et 4 atlas, Paris, Ed. Pillet, 1825-1837 (dernier volume posthume en 1844).
- Jean-Pierre La Selve « Séga et Maloya de La Réunion, musiques d’une île métisse », Tropiques métis. Mémoires et cultures de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, F. Pizzorni-Itié, M. Colardelle, D. Maximin, Paris, éd. Réunion des Musées nationaux, 1998, 142 p., p. 86-87.
- Robert Chaudenson, «Des îles, des hommes, des langues. Langues créoles – cultures créoles», Paris, L’Harmattan, 309 p., ch. septième.
- La manipulation désigne la fabrication du sucre de canne.
- Auguste Billiard, «Voyage aux colonies orientales» (1822, Librairie Française de Ladvocat, Paris), rééd. ARS Terres Créoles, coll. Mascarin, 1990, 254 p., p. 95.
- Abbé Macquet, op. cit.
- « L’ancive est un coquillage servant de trompe primitive, son usage est universellement répandu ; elle a peut-être été utilisée comme signal d’appel au travail sur les plantations » ; « le bobre, ou arc musical commun à l’Afrique et à Madagascar, pincé à Madagascar, toujours battu à Bourbon ; l’arc est en bois de pomme marron, la corde en fibre de choka, la caisse de résonance est une calebasse, coulissant grâce à un anneau fixe sur la corde et sur le manche. Bernardin de Saint-Pierre est le premier à le citer à propos de la danse des Malgaches », Jean-Pierre La Selve, «Musiques traditionnelles de La Réunion», Saint-Denis, Azalées Editions, 1995, 271 p., voir chap. IV Musiques traditionnelles de La Réunion, Saint-Denis, Azalées Editions, 1995, 271 p., voir chap. IV ; « La cithare tubulaire valiha n’est pas restée dans la mémoire collective des Réunionnais, tout en conservant son nom », Yu Sion Live « Approche pour une étude du métissage des instruments de musique de l’océan Indien », KABARO. Diversité et spécificité des musiques traditionnelles de l’océan Indien, vol. II, 2-3, dir. Yu Sion Live et J.-F. Hamon, Université de La Réunion, Faculté des Lettres et Sciences humaines, L’Harmattan, 2004, 296 p.
- Léonard, «Voyage aux Antilles», Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1798.
- Le concept d’expression (…) est propre au XVIIIe siècle et concerne la composition comme la pratique d’exécution. La musique expressive est celle qui émeut le public, ou, selon Berlioz, qui « veut exciter les passions », et peut rendre des sentiments variés et même opposés, voir Danielle Bouverot, « “L’expression” en peinture et en musique (1830-1850 », Romantisme, 1991, n° 71, p. 69-84.
- « Ce matin, en me levant, j’ai entendu des chants de Noirs, comme s’ils portaient une voiture et, venant à l’établissement, je suis sorti de suite et j’ai vu effectivement un manchil dans lequel arrivait en triomp(h)e la bonne Md Welment », Lescouble (1824).
- Victorine Monniot, «Le Journal de Marguerite ou les deux années préparatoires à la première communion», Dix-neuvième édition, t. I et II, Paris, 1876, Librairie catholique Périsse frères, t. 2.
- « Chaque travail que l’on fait aux champs a sa musique particulière : la première démarche pour une nouvelle plantation … consiste dans le débroussaillement du terrain. Ce travail s’accompagne souvent du rythme du tambour de bois : petit tambour en bambou dans l’ouest, grand instrument de bois ailleurs. Souvent des chanteurs simulent avec ou sans tambour de bois ce travail qui se fait dans une ambiance euphorique ; les débroussailleurs font des mouvements de danse, frappent rythmiquement la machette dans le sous-bois, poussent des exclamations », Hugo Zemp, Musique Dan. La musique dans la pensée et la vie sociale d’une société africaine, Cahiers de l’homme. Ethnologie, géographie, linguistique, Nlle série IX, Paris, Mouton, La Haye, 1971, 320 p.
- Georges Mareschal de Bièvre, « La Vie créole à l’île Bourbon pendant la Révolution », Revue des études historiques, 1930. 6e année 96, p. 395-416, p. 408-409.
- Louis Claude de Saulces de Freycinet, Voyage autour du monde exécuté sur les corvettes de S. M. l’Uranie…, op. cit.
- Eugène Dayot, «Bourbon pittoresque ; Poèmes ; Variétés», 2e éd., présentée et annotée par Jacques Lougnon, Saint-Denis de La Réunion, Nouvelle imprimerie dionysienne, 1977.
- Le terme bamboula (tambour africain) désigne à la fin du XVIIIe siècle une danse syncopée exécutée au rythme du tambour lors des cérémonies à Haïti. Importé aux États-Unis, via la Louisiane par l’entremise d’esclaves, le terme se généralise dans les Antilles avant d’être appliqué, de manière dépréciative, aux danses et musiques de l’ensemble des esclaves noirs africains.
- Charles-Hubert Lavollée, «Voyage en Chine», Paris, J. Rouvier – A. Ledoyen, 1852 (à Bourbon en 1843), 478 p.
- Jean-Claude Piguet, « Philosophie et Musique. Trois approches philosophiques de la musique : la phénoménologie, le pythagorisme, et la philosophie du langage », http://centre-bachelard.u-bourgogne.fr/Z-piguet.pdf.